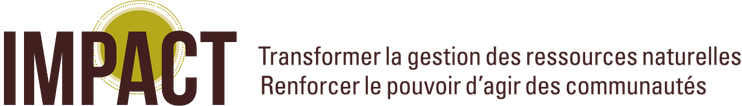Au cœur de la forêt équatoriale du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), des femmes sont rassemblées dans une pièce à peine éclairée. Elles bravent l’humidité et l’insécurité ambiantes pour réfléchir aux enseignements des derniers mois. L’une après l’autre, elles se lèvent et prennent la parole. Leurs voix se font de plus en plus fortes, plus confiantes et plus assurées tandis qu’elles racontent comment elles ont appris à avoir des droits égaux au sein de leurs ménages, à contrôler leurs finances et à prendre des décisions concernant leurs corps.
Cette prise de conscience a trouvé un écho particulier chez chacune de ces femmes. Certaines disent être convaincues qu’il est inacceptable qu’un mari frappe sa femme; d’autres évoquent leur droit de gérer leurs revenus, de diriger une équipe d’exploitantes et d’exploitants miniers et même de posséder une mine.
Pour ces femmes, dont la vie et les moyens de subsistance sont étroitement liés à l’exploitation aurifère artisanale, le moment est venu d’agir ensemble et de s’engager à faire avancer leurs droits, non seulement comme femmes, mais aussi comme exploitantes minières. C’est de cette détermination commune qu’est née, dans la province de l’Ituri, la première association d’exploitantes minières de la région, le Réseau pour l’autonomisation des femmes dans les communautés minières (REAFECOM).
Ce jour-là, les femmes se sont engagées à lutter contre les inégalités systémiques qui sévissent au sein de leur communauté et d’affronter les obstacles tenaces qui se dressent devant elles, aussi bien sur le site minier qu’au sein de la chaîne d’approvisionnement.
Dans les mines, les femmes étaient reléguées à des postes moins bien rémunérés. De plus, elles étaient systématiquement exclues de certaines tâches plus lucratives. Elles étaient victimes de stigmatisation et de discrimination et n’avaient pas un accès égal à certains équipements, aux puits ou sites miniers. Les femmes n’étaient pas autorisées à vendre l’or qu’elles avaient extrait elles-mêmes, ni à décider de l’utilisation de leur propre revenu. Aucune femme n’occupait de poste de direction dans les mines ni dans la seule coopérative minière locale.
Dans le cadre du travail d’IMPACT, qui vise à soutenir une gestion plus équitable et plus transparente des ressources – notamment par la promotion de chaînes d’approvisionnement responsables – il est essentiel de comprendre quelles sont les inégalités systémiques à l’œuvre, car c’est dans ce contexte que nos interventions sont conçues et mises en œuvre.
Dans le secteur de l’exploitation aurifère artisanale, qui est au cœur du développement économique des communautés environnantes, les interventions visant à régler les difficultés du secteur de l’EMAPE (exploitation minière artisanale et à petite échelle) qui sont trop restrictives sur le plan technique ou qui sont propres à la chaîne d’approvisionnement risquent d’échouer si l’on ne traite pas les inégalités, les conflits et les déséquilibres de pouvoir qui sous-tendent ces difficultés.
Pour favoriser l’inclusion et lutter contre la discrimination fondée sur le genre, IMPACT met donc l’accent sur des approches communautaires, mises au point par la communauté elle-même et adaptées au contexte local. Ainsi, IMPACT vise à promouvoir un changement progressif des comportements et à donner aux communautés de l’EMAPE les moyens de relever durablement les défis auxquels elles sont confrontées. Parallèlement, il s’agit d’aider les communautés à tirer parti des possibilités que peut créer la production de minérais, en s’assurant que la pleine participation des femmes à toutes les tribunes, quel que soit leur âge, est une priorité.
Comprendre l’écosystème au sens large
L’exploitation minière artisanale est une bouée de sauvetage essentielle pour des millions de personnes dans le monde. Elle est une source de précieux revenus, là où d’autres secteurs offrent peu de débouchés économiques.
Même si l’exploitation minière reste le principal moteur économique pour la plupart, l’économie locale de ces communautés ne dépend pas seulement de l’extraction de minérais. Elle s’appuie aussi sur un réseau complexe d’activités liées entre elles, comme l’agriculture, le commerce et les petites entreprises.
Pour bon nombre d’exploitantes et d’exploitants miniers, les revenus tirés des mines constituent un tremplin essentiel vers d’autres activités génératrices de revenus. Selon ce que nous avons pu observer sur le territoire de Mambasa, ces activités comprennent l’achat d’une plantation de cacao, la construction de maisons avec des logements à louer, la création d’une entreprise ou d’un restaurant, ou la location d’un étal sur le marché local pour vendre des marchandises.
Furaha, qui est membre du REAFECOM, illustre bien la manière dont les exploitantes et exploitants miniers diversifient leurs stratégies de revenus. En plus de diriger une équipe d’exploitantes minières, elle tient un restaurant sur le site minier. Elle y sert des repas aux exploitantes et exploitants. Elle s’assure ainsi d’une source de revenus stable, même si l a production de minérais diminue.
Des exploitantes et exploitants miniers de communautés semblables tendent à trouver un équilibre économique en jumelant l’exploitation minière avec l’horticulture à petite échelle, ou encore en se tournant provisoirement vers des activités agricoles comme la récolte du cacao ou du riz. Parallèlement, les négociants jouent un rôle central dans l’économie locale, car ils font circuler l’argent, ils consentent des prêts et garantissent l’accès aux biens et services de base. Dans ce sens, ils tiennent le rôle de « banque communautaire ». Cette dynamique montre que le contexte économique plus large des communautés pratiquant l’EMAPE doit peser dans la balance quand on cherche des solutions. En effet, les solutions ciblant seulement l’exploitation minière ne tiennent pas forcément compte de la fluctuation saisonnière des revenus ni de l’interdépendance des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
Les dynamiques sociales qui se jouent au sein des communautés pratiquant l’EMAPE ajoutent à la difficulté de concevoir des interventions efficaces. Les disparités entre les genres sont profondément enracinées. En effet, dans le secteur minier, les hommes occupent généralement les tâches requérant le plus de mobilité et les plus exigeantes physiquement, tandis que les femmes sont plutôt reléguées à la transformation des minerais et à l’entretien du foyer. Cette division du travail entre les hommes et les femmes limite non seulement l’accès des femmes aux débouchés économiques, mais les rend également particulièrement vulnérables aux chocs économiques et à la marginalisation sociale.
Dans les communautés pratiquant l’EMAPE, les enfants et les populations autochtones connaissent également certaines difficultés. Bien que le travail des enfants soit interdit dans la plupart des pays, les enfants et les adolescentes et adolescents se retrouvent souvent sur les sites miniers en raison de l’insécurité socio-économique des familles, en particulier des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Cela limite l’accès des jeunes à l’éducation et perpétue le cycle d’exploitation et de pauvreté. En outre, lorsque l’exploitation aurifère n’est pas réglementée, l’environnement se dégrade, ce qui prive les communautés locales, en particulier les peuples autochtones pygmées, des moyens de protéger leurs terres et leurs droits ancestraux. Ces populations sont presque toujours exclues des processus décisionnels et ne disposent pas des ressources nécessaires pour défendre leurs droits et protéger leurs forêts.
Autonomisation des femmes par la création de groupes d’épargne
L’un de nos projets phares, Autonomisation des femmes par l’épargne et le crédit communautaire responsable (AFECCOR), d’abord réalisé en RDC, puis au Burkina Faso et au Mali, illustre parfaitement le caractère holistique des interventions d’IMPACT.
L’AFECCOR met en place des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) dans les communautés minières artisanales pour que les membres aient accès à du financement et puissent améliorer leurs compétences financières. Le manque d’accès au financement est un problème qui touche l’ensemble des exploitantes et exploitants miniers, ce qui les rend plus vulnérables au système informel de prêt abusif et à l’insécurité économique, surtout les femmes. Pour que nos efforts en matière de financement portent des fruits, il faut tenir compte des obstacles supplémentaires qui se dressent devant les femmes dans ce domaine – et du degré élevé d’inégalité entre les genres dont sont victimes bien des femmes dans les communautés de l’EMAPE. Le modèle AFECCOR intègre justement une approche de sensibilisation et de transformation des rapports entre les sexes qui vise à accroître la reconnaissance et l’appréciation, tant par les femmes que par les hommes, de la contribution économique des femmes au ménage, ce qui contribue à la cohésion sociale de la communauté.
Concrètement, comment cela se traduit-il? Pour commencer, il s’agit d’employer des méthodes axées sur le dialogue pour aider les femmes et les hommes à reconnaître et à apprécier la valeur des femmes, y compris leur contribution à l’EMAPE et leur apport financier au ménage. Les femmes participant au projet échangent dans le cadre de séances de discussion et sont amenées à cerner les obstacles qui, dans leur vie, les empêchent d’améliorer leur situation socio-économique et leur propre sécurité. Cette démarche les encourage à trouver ou à amplifier leur voix et à acquérir la confiance nécessaire pour reconnaître et remettre en question les sources d’inégalité et de privation de droits.
Les femmes participant au projet sont encouragées à parler avec leur conjoint de questions comme le budget du ménage et le contrôle des finances. Une telle approche contribue non seulement à réduire le risque de violence fondée sur le genre, qui survient parfois lorsqu’une femme veut s’émanciper sur le plan économique, mais elle peut aussi modifier le regard collectif porté sur les femmes, sur le genre et sur l’égalité des genres et ouvrir ainsi la voie à l’acceptation d’un leadership et d’une émancipation économique accrus des femmes. Pendant toute la durée du projet, les femmes sont encouragées à assumer des postes de responsabilité, aussi bien à titre de bénévoles communautaires que de membres du comité de gouvernance de l’association villageoise d’épargne et de crédit (AVEC), où elles sont souvent respectées et jugées dignes de confiance en matière de gestion des finances. Grâce à cette expérience, les femmes ont l’occasion de renforcer leurs capacités de leadership, et de bénéficier d’avantages qui vont au-delà du projet. Par exemple, le Réseau pour l’autonomisation des femmes dans les communautés minières (REAFECOM) est né de l’initiative de femmes participant aux AVEC qui ont reconnu leur intérêt commun à s’organiser pour défendre les intérêts des exploitantes minières de leurs communautés.
Les femmes en tant qu’artisanes de la paix
Très tôt, les membres du REAFECOM ont constaté que les effets de conflits localisés – souvent enracinés dans l’inégalité entre les genres ou exacerbés par celle-ci – représentaient une menace particulière pour leur propre sécurité. Elles ont constaté que de nombreuses femmes étaient vulnérables en raison de pratiques ou d’opinions dépasséees. Elles ont donc cherché des solutions locales pour corriger cette situation. C’est ainsi qu’est né le projet Femmes de paix.
Dans le cadre de ce projet, conçu en collaboration avec le REAFECOM, les membres ont suivi une formation en médiation et résolution de conflits afin d’acquérir les outils pour diriger les efforts de paix au sein de leur communauté. L’accent a été mis sur les sources locales de conflit et de tension, y compris entre les membres d’une même famille et entre conjoints. Avec le soutien d’IMPACT, dans les communautés et sur les sites miniers, 14 noyaux de paix ont ainsi été créés, au sein desquels des femmes ont agit comme médiatrices dans les conflits, favorisant la cohésion sociale et luttant contre la violence fondée sur le genre.
Les dialogues communautaires ont été le point culminant du projet. Ils ont réuni diverses parties prenantes, notamment le président du Tribunal de paix et des enfants de Mambasa, des fonctionnaires de l’État, la police spéciale pour la protection des femmes et des enfants et des leaders communautaires. Pour la première fois, ces groupes ont collaboré avec REAFECOM pour étendre la justice, sensibiliser la population et traiter les problèmes systémiques au sein des communautés.
Les dialogues ont servi de plateforme de réflexion et d’autonomisation pour la communauté, et favorisé la recherche de solutions pour régler des problèmes de longue date. Les femmes ont fait part de leurs difficultés financières familiales, de l’absence de propriété foncière et de l’inégalité de traitement dans le cadre des pratiques coutumières. Les noyaux de paix ont joué un rôle essentiel, car leur travail de médiation a permis de nommer ces difficultés et de montrer qu’il était possible de trouver des solutions pacifiques lorsque les droits des femmes et la non-violence sont des priorités.
Ce projet, qui intègre le travail des noyaux de paix, soutient les victimes de violences et plaide auprès des autorités, et montre le potentiel d’un changement impulsé par la communauté. Il a contribué à établir la légitimité des noyaux de paix et à garantir que la voix et les droits des femmes sont au cœur de la résolution des conflits. Cela est essentiel pour les communautés pratiquant l’EMAPE, dans un contexte où la question de l’accès aux ressources, en particulier à la terre, peut créer des tensions qui dégénèrent en conflit et perturbent les moyens de subsistance. Ces conflits impliquent souvent toute une série d’actrices et acteurs locaux autres que les exploitantes et exploitants miniers, notamment des négociants, des propriétaires fonciers et des prestataires de services. Pour résoudre les conflits et promouvoir la paix dans ces communautés, il est nécessaire de reconnaître l’ensemble des relations qui sous-tendent les économies de l’EMAPE et de favoriser des approches inclusives qui reflètent l’interdépendance des rôles au sein de la chaîne d’approvisionnement.
Gouvernance communautaire
Les stratégies intégrées d’IMPACT visent à favoriser directement la mise en place de chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’EMAPE. Ces efforts, qui répondent aux besoins socio-économiques et renforcent la résilience à long terme des communautés pratiquant l’EMAPE, jettent les bases de chaînes d’approvisionnement inclusives, transparentes et conformes aux normes internationales en matière d’approvisionnement responsable. Le renforcement de la cohésion communautaire, la promotion de l’égalité des genres et la priorité accordée à la gestion environnementale ne sont pas de simples objectifs de développement. Il s’agit d’éléments cruciaux à une gestion équitable des ressources et à une juste répartition des bénéfices.
Par exemple, l’expérience acquise par IMPACT lors de la mise en œuvre du projet Or Juste a confirmé que le fait d’ignorer l’inégalité des genres risque de nuire à la réussite et à la durabilité des efforts d’approvisionnement responsable. On a tenu compte de la perspective du genre dès le début du projet. Les femmes ont ainsi pu renforcer leur position au sein de la chaîne d’approvisionnement et avoir accès à du financement, ce qui a favorisé la formalisation du secteur et renforcé la cohésion sociale. À mesure que les femmes ont gagné en visibilité et en confiance, elles ont ardemment défendu les principes qui sous-tendent l’approvisionnement responsable, notamment la transparence, la bonne gouvernance et l’équité. L’approvisionnement responsable ne se limite pas à la traçabilité des minérais : il exige des systèmes inclusifs et durables qui respectent les droits de la personne et encouragent la participation communautaire. Dans le cadre du projet, les femmes sont devenues les plus grandes championnes de ces principes. Elles ont fait avancer le projet et ont renforcé sa légitimité au sein de la communauté.
En fin de compte, à long terme, la durabilité repose sur l’appropriation par la communauté et sur des structures de gouvernance adaptative. En arrimant le développement local aux pratiques de la chaîne d’approvisionnement mondiale, on peut non seulement mettre en place des systèmes responsables et équitables, mais également résilients face aux défis que nous réserve l’avenir. Ainsi, des exploitantes minières comme celles de REAFECOM, et leurs communautés auront leur mot à dire dans l’élaboration de solutions durables.
Le travail d’IMPACT vise à transformer la gestion des ressources naturelles au moyen de stratégies de sensibilisation donnant aux exploitantes et exploitants miniers – à commencer par les groupes les plus défavorisés comme les femmes et les peuples autochtones – ainsi qu’à leurs communautés, les moyens de réfléchir à l’impact de leurs activités sur leur stabilité économique et leur bien-être. Grâce à une sensibilisation ciblée, ces groupes et leur communauté au sens large peuvent devenir des agents actifs de la gestion du changement, ce qui les rend plus autonomes par rapport aux interventions extérieures et plus aptes à entretenir par elles et eux-mêmes les progrès réalisés.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour un or artisanal plus respectueux de l’environnement
Comment les noyaux de paix améliorent-ils la sécurité des femmes dans les communautés minières
Les associations d’épargne communautaires contribuent à la formalisation du secteur minier artisanal