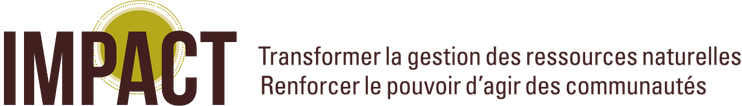La ruée mondiale vers les minéraux critiques a, une fois de plus, mis en évidence les effets néfastes de l’exploitation minière sur les communautés locales. Les regards sont notamment braqués sur la République démocratique du Congo (RDC), premier pays producteur de cobalt. Les appels lancés aux entreprises afin qu’elles veillent à ce que leurs chaînes d’approvisionnement soient exemptes de travail infantile ont trouvé un large écho. De même, les préoccupations concernant les conditions de sécurité sur les sites d’extraction et la dégradation de l’environnement ont suscité une attention croissante. Mais ce regain d’intérêt a conduit certaines entreprises à adopter des politiques qui ne sont pas fondées, qui ciblent sans distinction tous les acteurs du secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE), allant même jusqu’à bannir totalement l’achat de minéraux issus de cette filière.
Les entreprises et leurs gouvernements respectifs sont soucieux de trouver des sources d’approvisionnement « propres » en minéraux critiques et de démontrer que leurs achats ne cautionnent pas les atteintes aux droits de la personne et les dommages environnementaux au sein des communautés minières. C’est dans ce contexte que la dynamique en faveur d’une meilleure traçabilité a pris de l’ampleur depuis un an.
Récemment, le groupe d’experts du Secrétaire général de l’ONU sur les minerais essentiels à la transition énergétique a recommandé la mise en place d’un « cadre mondial de traçabilité, de transparence et de responsabilité tout au long de la chaîne de valeur des minéraux, de l’extraction au recyclage ». L’objectif est de renforcer l’exercice du devoir de diligence, de faciliter la responsabilité des entreprises et de créer un marché mondial pour les minéraux essentiels à la transition énergétique.
Cependant, on a déjà tenté à plusieurs reprises d’instaurer un système de traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux artisanaux – comme les diamants, l’or et les 3T (étain, tantale et tungstène) – afin de lutter contre les atteintes aux droits de la personne et le financement des conflits. Ces initiatives n’ont reçu qu’une reconnaissance limitée, n’ont pas été bien comprises et ont donné des résultats mitigés. Il serait donc bon de tirer les enseignements de ces expériences afin de mettre au point des mécanismes plus efficaces.
Traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement
Diamants
La traçabilité est un vieux serpent de mer dans le secteur de l’exploitation minière des diamants. À ce jour, il n’existe toujours pas de système de traçabilité à l’échelle de l’industrie qui fasse l’objet d’un audit indépendant et permettrait de suivre les diamants de la mine jusqu’au consommateur.
Le Système de certification du Processus de Kimberley, mis en place en 2003, vise à garantir que les diamants bruts ne proviennent pas de zones de conflit. Les pays signataires du Processus s’engagent à instaurer des « contrôles internes » afin de s’assurer que des diamants de conflit ne pénètrent pas leur marché. Le certificat délivré à l’exportation pour chaque colis de diamants bruts suppose que le gouvernement est en mesure de retracer l’origine des minéraux jusqu’à leur site d’extraction. Mais la réalité est souvent tout autre.
De nombreux rapports ont fait état de contrôles internes défectueux au sein des pays concernés, en particulier lorsque la production est artisanale. En effet, plusieurs États ne fournissent pas de preuves tangibles de traçabilité et laissent ainsi des diamants illicites ou de conflit intégrer la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, étant donné que la certification intervient uniquement au moment de l’exportation depuis le pays d’origine et ne concerne que les diamants bruts, il est possible que des minéraux illicites soient glissés dans les colis, tant dans les centres de négoce que lors des phases de taille ou de polissage. Le système de garanties du Conseil mondial du diamant (CMD) souffre, quant à lui, d’un manque de transparence et de contrôle indépendant rigoureux, et n’est pas conforme aux normes internationales. Les membres du CMD procèdent à une autoévaluation à partir d’un ensemble de critères et s’appuient généralement sur la certification du Processus de Kimberley pour déterminer la preuve de l’origine des diamants, sans tenir compte des conditions dans lesquelles ils ont été extraits et commercialisés.
Toutefois, l’actualité géopolitique, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a relancé la dynamique en faveur d’une chaîne d’approvisionnement en diamants plus rigoureuse et plus transparente. Étant donné que la Russie compte parmi les principaux producteurs de diamants et qu’il est désormais interdit aux entreprises d’en importer depuis de ce pays, la nécessité de mettre en place un système de traçabilité efficace est devenue plus pressante. En effet, depuis le 1er janvier 2024, le G7 interdit l’importation de diamants d’origine russe. Depuis le 1er mars 2024, cette mesure touche les diamants russes de plus d’un carat, taillés et polis ailleurs dans le monde.
Dans l’industrie du diamant, les modalités d’application d’un système de traçabilité restent floues, d’autant que les tensions entre acteurs du secteur sont nombreuses. En outre, selon plusieurs rapports, les technologies nécessaires à l’instauration d’un mécanisme efficace ne sont pas encore opérationnelles. Le G7 a donc dû reporter de près d’un an (au 1er janvier 2026) ses exigences en matière de traçabilité. Entre-temps, les États-Unis ont annoncé que les importateurs pourront « autocertifier » le pays d’extraction pour se conformer aux nouvelles exigences – une mesure en décalage total avec les normes de traçabilité les plus rudimentaires.
3T
Peu avant l’adoption, en 2010, de l’article 1502 de la loi Dodd-Frank aux États-Unis – qui oblige les entreprises à déclarer tout approvisionnement en or ou en 3T en provenance de la RDC ou de ses pays limitrophes –, le secteur privé a commencé à expérimenter divers mécanismes de traçabilité dans l’industrie des 3T. Portée par la pression réglementaire et la volonté d’éviter le financement indirect de groupes armés dans la région africaine des Grands Lacs, une phase pilote du programme iTSCi a alors été lancée. Ce système de traçabilité des 3T, géré par les acteurs de l’industrie, a d’abord été mis en œuvre en RDC, avant d’être rapidement étendu à l’ensemble de la région.
Le programme iTSCi visait à soutenir l’accès au marché des 3T dans la région, à un moment où les acheteurs en aval subissaient une pression croissante de la part des consommateurs et des organismes de réglementation afin d’empêcher que des minéraux de conflit ne s’insinuent dans leurs chaînes d’approvisionnement. Ce mécanisme a toutefois été remis en question, notamment parce qu’il instaure une forme de monopole sur les dispositifs de diligence raisonnable. Il a donc été accusé de freiner l’émergence d’autres initiatives et d’assurer la mainmise sur les achats de 3T aux membres du programme.
À ce jour, peu d’autres systèmes de traçabilité dans l’industrie des 3T ont réussi à dépasser le stade du projet pilote ou à s’étendre au-delà d’une poignée de sites, à l’exception du programme Better Mining. Déployé en RDC et au Rwanda à une échelle plus réduite que le programme iTSCi, il concerne également d’autres chaînes d’approvisionnement en minéraux, comme celle du cobalt.
Le programme iTSCi a été la cible de nombreuses autres critiques, en particulier pour son incapacité à combler certaines lacunes majeures – des failles qui ouvrent la porte à des pratiques frauduleuses et à l’achat de minéraux d’origine douteuse. Récemment, l’initiative a même perdu la reconnaissance de la Responsible Minerals Initiative (RMI), malgré trois années de discussions pour corriger ces insuffisances. L’organisme a indiqué que la reconnaissance du programme iTSCi ne lui semblait pas compatible avec sa mission, qui est de promouvoir un approvisionnement responsable en minéraux dans les zones de conflit et à haut risque.
La structure de coûts du programme iTSCi a elle aussi été pointée du doigt, car elle fait peser une charge financière importante sur les acteurs en amont, en particulier sur les exploitantes et exploitants miniers artisanaux. Ces coûts, souvent prohibitifs, constituent un obstacle à la participation et encouragent les circuits commerciaux parallèles. De l’aveu même d’iTSCi, ce sont les maillons en amont de la chaîne qui supportent l’essentiel des frais (80 % du financement de l’initiative). Le programme s’attelle désormais à relever la part des contributions en aval pour la faire passer de 1 à 10 %.
La question du financement de la traçabilité et du devoir de diligence ne se limite pas au secteur des 3T. Elle a d’ailleurs conduit l’OCDE à publier une déclaration de principes sur l’estimation des coûts et de la valeur du devoir de diligence.
Or
Dans le secteur de l’or artisanal, le chemin vers la traçabilité est semé d’embûches. Aujourd’hui encore, les investissements sont limités et les tentatives visant à instaurer un système durable et évolutif n’ont connu que peu de succès, tant en RDC que dans le reste du monde.
La nature clandestine et fragmentée des chaînes d’approvisionnement en or artisanal – où de petites exploitations minières situées dans des zones reculées s’appuient sur des réseaux informels pour écouler leur production – constitue un frein majeur aux efforts de traçabilité. La coordination de ces réseaux dispersés nécessite des ressources considérables et, en l’absence de contrôle centralisé, l’harmonisation des pratiques représente un défi de taille.
Les coûts associés à la mise en place d’un système de traçabilité dans un environnement aussi fragmenté et décentralisé sont souvent très élevés, ce qui dissuade les acteurs en amont de s’impliquer. Comme dans le cas des 3T, une question reste entière : qui est prêt à financer ces systèmes de traçabilité? L’expérience d’IMPACT en matière de traçabilité de l’or en RDC montre que les acteurs en aval sont peu enclins à mettre la main au portefeuille. Cette réticence fait fréquemment peser une charge financière disproportionnée sur les maillons en amont de la chaîne, propre à décourager les meilleures volontés.
Et la forte valeur de l’or, combinée à son faible volume, complique encore la situation : elle fait de ce minéral une cible de choix pour les réseaux de contrebande et de blanchiment d’argent, ce qui attire de nombreux acteurs vers des circuits de vente parallèles. En effet, les contrebandiers peuvent aisément transporter l’or sous le manteau d’un pays à l’autre et ainsi contourner les circuits officiels, tout en échappant aux mesures de traçabilité. À cela s’ajoute le problème de la fongibilité de l’or : un lingot, par nature, ne se distingue pas d’un autre. Cette caractéristique complique considérablement les efforts de transparence, en particulier dans les régions où les frontières sont poreuses et les mécanismes de contrôle peu efficaces.
Par ailleurs, les lacunes réglementaires dans des marchés clés, tels que les Émirats arabes unis et l’Inde, fragilisent sérieusement les dispositifs de traçabilité en place. Faute de rigueur dans l’application des exigences en matière de transparence et de devoir de diligence, ces pays laissent l’or entrer illicitement sur le marché légal, sans réel contrôle. L’absence de cadre mondial harmonisé pour réglementer les chaînes d’approvisionnement en or ne fait qu’aggraver ces difficultés et porte atteinte à l’efficacité et à la fiabilité des systèmes de traçabilité à l’échelle internationale.
Enfin, de plus en plus d’entreprises n’hésitent pas à jouer la carte de l’or recyclé afin de contourner leurs obligations en matière de traçabilité. Ce stratagème leur permet d’éluder les défis liés à la traçabilité des matières premières et de mettre sous le tapis les problèmes structurels de transparence et de responsabilité dans les chaînes d’approvisionnement. Leur attitude nuit à la crédibilité des systèmes de traçabilité existants et sape les efforts en cours pour améliorer les conditions dans les zones d’extraction.
Principaux enseignements à tirer des précédentes initiatives de traçabilité
Bien que le contexte entourant les initiatives de traçabilité dans les secteurs du diamant, de l’or et des 3T varie, IMPACT a pu observer plusieurs similitudes concernant la nature des difficultés. Leur analyse prend tout son sens à l’heure où les appels à la traçabilité des minéraux critiques se multiplient.
La traçabilité, pour qui?
Dans un récent rapport intitulé Le rôle de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) soulignent : « La traçabilité ne constitue pas une fin en soi : les systèmes mis en place doivent servir des objectifs précis. »
La question se pose donc de savoir à qui s’adresse la traçabilité des minéraux.
Jusqu’à présent, les efforts de traçabilité dans les secteurs du diamant, de l’or et des 3T ont principalement aidé les entreprises à prouver qu’elles ne s’approvisionnaient pas dans des zones à haut risque, où la chaîne d’approvisionnement posait problème. L’absence de systèmes crédibles et véritablement efficaces a conduit à l’adoption de politiques réactionnaires dans le secteur privé. Certaines entreprises ont carrément choisi de se détourner des minéraux issus de l’EMAPE tandis que d’autres ont instauré des systèmes à la va-vite, malgré des inquiétudes et des dysfonctionnements notables.
Ce qui fait fréquemment défaut dans ces initiatives, c’est un questionnement réel sur les objectifs des acteurs qui produisent ces ressources dans les pays en développement, et notamment les membres des communautés minières elles-mêmes.
Les communautés de l’EMAPE se sont vu imposer des systèmes de traçabilité sans que l’on s’intéresse véritablement à leurs objectifs ni aux avantages qu’elles pourraient en tirer. Faute de s’approprier ces systèmes et d’en percevoir les bénéfices, de nombreux acteurs en amont, encouragés ou contraints à rendre compte de l’origine de leurs minéraux, ignorent, contournent ou manipulent les dispositifs de traçabilité en place. Ils s’adaptent à un environnement local dominé par la contrebande, la gouvernance traditionnelle, le favoritisme, l’insécurité foncière et la corruption.
En somme, les mécanismes de traçabilité ont souvent été instaurés sans véritable prise en compte des réalités du terrain et des besoins des populations directement impliquées dans l’exploitation artisanale et à petite échelle des minéraux.
À ce titre, l’exemple du secteur des 3T dans la région africaine des Grands Lacs est particulièrement éloquent. Les voix discordantes se font de plus en plus nombreuses à l’égard de systèmes de traçabilité et de lois jugés impropres à améliorer la paix et la sécurité au sein des communautés minières et de mettre fin au financement des conflits. Certains estiment même que les dispositifs de traçabilité ont fini, malgré eux, par nuire aux personnes qu’ils étaient censés soutenir.
Des défis qui ne se cantonnent pas aux premiers maillons de la chaîne
La plupart des systèmes de traçabilité ont mis l’accent de façon disproportionnée sur le « premier kilomètre » des chaînes d’approvisionnement en minéraux, c’est-à-dire le lieu même de leur extraction. Mais il est vite apparu que de nombreux problèmes persistaient aussi au milieu de la chaîne.
Les points où les minéraux convergent, en particulier ceux où ils sont traités et mélangés, posent de sérieux défis en matière de traçabilité. De l’or affiné aux Émirats arabes unis ou des diamants taillés en Inde ne conservent souvent aucune trace de leur origine une fois regroupés avec des minéraux issus de différentes sources. Même quand un pays ou un acteur prend des mesures concrètes en faveur de la traçabilité, les progrès accomplis sont compromis ou éclipsés dès lors que les minéraux sont mélangés. Dans ces conditions, il devient difficile d’assurer la responsabilité des maillons en aval de la chaîne d’approvisionnement.
Il s’agira certainement d’un défi majeur pour les minéraux critiques, tels que le cobalt, dont plus de 65 % de la production mondiale est affinée en Chine.
En fait, le problème se pose pour tous les types d’exploitation minière, qu’elle soit artisanale ou industrielle, car même un seul minéral d’origine douteuse peut nuire à l’ensemble de la chaîne lorsqu’il est mélangé à d’autres. Et de nouveaux défis émergent avec l’utilisation de minéraux recyclés.
Qui paie?
La question du financement du système de traçabilité a été un point récurrent dans toutes les chaînes d’approvisionnement sur lesquelles IMPACT est intervenue. Les discussions ont aussi bien porté sur les coûts initiaux liés à la conception et à la mise en œuvre du dispositif que sur les frais de fonctionnement à long terme.
Bien que de nombreuses entreprises en aval appellent à une meilleure traçabilité des minéraux dans leurs chaînes d’approvisionnement, elles se montrent nettement moins enclines à en assumer les coûts. Et même si certaines sont prêtes à assumer les frais de fonctionnement, l’absence d’investissement dans des systèmes évolutifs demeure un obstacle majeur. La situation est d’autant plus problématique que, lorsque les projecteurs sont braqués sur un problème précis – comme les diamants de conflit ou le travail des enfants dans le secteur du cobalt –, on se précipite souvent pour mettre en place une solution de fortune, imposée aux acteurs en amont sans tenir compte des besoins à l’échelle locale.
Traçabilité : un outil et non une solution
La traçabilité est un outil parmi d’autres au service du devoir de diligence, mais ne saurait être une fin en soi. Elle permet aux entreprises de déterminer la provenance de leurs minéraux et de procéder aux vérifications nécessaires pour comprendre le contexte de production et de commercialisation ainsi que la structure de leur chaîne d’approvisionnement.
Cependant, ni la traçabilité ni le devoir de diligence ne suffisent, à eux seuls, à traiter les causes profondes des risques au sein des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques. C’est d’autant plus vrai lorsque les mécanismes mis en place ne tiennent pas compte des objectifs et des intérêts des populations directement concernées. En se concentrant uniquement sur la traçabilité des minéraux, sans s’attaquer aux risques systémiques et aux défis structurels liés à ces chaînes d’approvisionnement, les gouvernements et les acteurs privés pourraient perpétuer les cycles de la pauvreté et de l’insécurité, au lieu de les atténuer.
Paradoxalement, une focalisation excessive sur la traçabilité est susceptible de marginaliser les populations qu’elle entend protéger. Lorsque les exploitantes et exploitants miniers artisanaux sont exclus des dispositifs de traçabilité ou incapables d’en respecter les exigences, ils sont souvent contraints de se tourner vers des réseaux informels. Ils deviennent alors des proies faciles pour de nombreux acteurs peu scrupuleux. Il existe donc un risque réel de voir les minéraux critiques issus de l’exploitation artisanale être relégués au marché informel. Les acheteurs ont en effet tendance à privilégier les gros exploitants, dont les progrès en matière de traçabilité sont généralement plus rapides, compte tenu des économies d’échelle.
Le cap à suivre vers la traçabilité des minéraux critiques
L’une des leçons essentielles à tirer pour l’avenir du secteur des minéraux critiques est l’importance d’adopter une approche ascendante. C’est en impliquant les parties prenantes à l’échelle locale que l’on peut favoriser un sentiment d’appartenance et s’assurer que les bénéfices sont à la fois tangibles et équitablement répartis. Le processus doit également inclure les acteurs travaillant de manière informelle, voire illégale, sans quoi les efforts déployés pourraient être réduits à néant.
En outre, il est capital que les mécanismes de traçabilité prennent en compte les écosystèmes sociaux, économiques et politiques dans lesquels s’inscrivent les chaînes d’approvisionnement. Ignorer ces contextes pourrait conduire à des solutions précaires ou contre-productives. Par exemple, les dispositifs de traçabilité sont intrinsèquement liés aux circuits de vente officiels et leur mise en œuvre risque de perturber la structure de gouvernance ou le fonctionnement habituel de la chaîne d’approvisionnement, en raison de l’introduction de nouveaux processus, comme les paiements. Cette situation est susceptible d’engendrer une résistance de la part de celles et ceux qui percevraient ces systèmes comme une menace pour leur propre source de subsistance, de revenus ou de pouvoir.
Par ailleurs, la mise en place de systèmes de traçabilité à partir de zéro nécessite un financement solide, en particulier lors des premières phases. Il est souvent irréaliste de vouloir se reposer entièrement sur l’industrie ou sur des gouvernements aux ressources limitées. Bien que le rôle des pays donateurs ou d’autres bailleurs de fonds soit crucial pour amorcer un mécanisme de traçabilité efficace, il faut prévoir, dès le départ, une stratégie de sortie progressive de cette dépendance financière. Il incombe donc aux différents acteurs de faire preuve de bonne foi et d’engager un dialogue ouvert et transparent sur les coûts de fonctionnement des systèmes de traçabilité.
En outre, ces dispositifs ne doivent pas se cantonner à la production, mais englober aussi les activités de recyclage, de transport et de commerce. À défaut, la trace des minéraux risque de se perdre dans les rouages intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement, ce qui compromettrait la crédibilité et l’utilité du processus. Une démarche plus globale permet également de limiter la marge de manœuvre des acteurs malveillants et d’assurer une stratégie d’approvisionnement responsable, à la fois cohérente et fiable.
Au bout du compte, une approche trop restreinte de la traçabilité, principalement motivée par les besoins des entreprises en aval et déconnectée des réalités de l’exploitation minière artisanale, a peu de chances de réussir à long terme. Les systèmes de traçabilité et de diligence raisonnable ne doivent pas faire l’impasse sur un objectif majeur : apporter des avantages concrets aux communautés locales, selon les besoins qu’elles définissent elles-mêmes.
Certes, la traçabilité ne peut, à elle seule, résoudre la multitude de défis auxquels se heurtent les communautés de l’EMAPE. Mais si elle est pensée de manière inclusive et intégrée à des objectifs de développement plus larges, elle est susceptible de devenir le levier d’un changement positif. Il convient donc de mettre l’accent non plus sur les minéraux, mais sur l’humain, afin que les personnes directement touchées par l’exploitation minière aient leur place à la table des négociations.
Vous voulez en savoir plus?
La société civile boycotte le Système de certification des diamants de conflit