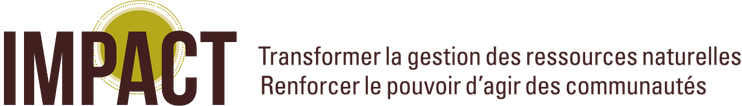Partout en République démocratique du Congo (RDC), les populations subissent la pression croissante des effets de changement climatique : chaleur intense, pluies abondantes et sécheresses prolongées qui bouleversent leur quotidien. Et les femmes et les Peuples Autochtones sont particulièrement touchés par la perte de biodiversité.
Les populations sont contraintes de s’adapter en adoptant différentes stratégies, par exemple en rotant leurs cultures et en recueillant et transformant des produits forestiers non ligneux (PFNL) plus largement accessibles, comme le miel et les champignons, pour remplacer ceux qui se raréfient.
Dans le cadre du projet Favoriser la résilience, IMPACT a mené une étude socio-environnementale pour connaître l’état des écosystèmes dans les zones d’intervention du projet et examiner comment ces régions sont touchées par les changements climatiques et l’exploitation minière. Les recommandations qui en découlent serviront à déterminer les moyens les plus efficaces et durables de favoriser la restauration et l’adaptation des écosystèmes, tout en aidant les populations à faire face aux répercussions de l’exploitation minière.
Une deuxième analyse s’est penchée sur les inégalités liées au genre et les dynamiques d’intersectionnalité afin de promouvoir une gestion plus équitable des ressources naturelles – en particulier pour les femmes, les jeunes et les Peuples Autochtones. Elle a également porté sur les conflits dans les régions concernées afin de proposer des mécanismes de résolution non violente adaptés au contexte local.
Ces travaux de recherche ont été menés dans quatre provinces de la RDC, à savoir les provinces de l’Ituri et de la Tshopo, au nord-est, et les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, au sud-est.
Principaux constats et recommandations du diagnostic socio-environnemental
L’évaluation a mis en évidence des enjeux environnementaux communs à toutes les régions ciblées par le projet Favoriser la résilience, à savoir :
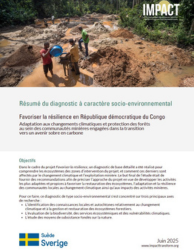
- Une biodiversité menacée dans tous les lieux d’intervention, en particulier dans l’Ituri et le Haut-Katanga, du fait de la déforestation, de l’exploitation minière et de l’agriculture sur brûlis;
- La pollution des cours d’eau attribuable à l’exploitation minière artisanale et industrielle;
- Les répercussions des changements climatiques sur le quotidien et les récoltes : températures à la hausse, précipitations irrégulières, inondations et sécheresses.
L’étude a mis en lumière les vulnérabilités et les stratégies d’adaptation des communautés locales, ainsi que les savoirs des populations locales et des Peuples Autochtones Pygmées pour protéger et restaurer les écosystèmes . Par exemple, les communautés de l’Ituri et de la Tshopo doivent composer avec une hausse des précipitations et des inondations, tandis que leurs voisins du Sud sont confrontés à une élévation des températures et à des épisodes de sécheresse. Partout, les populations ont développé un large éventail de stratégies d’adaptation pour faire face aux aléas climatiques, au dérèglement des cycles saisonniers, à la déforestation, à la perte de biodiversité et à la difficulté d’accès aux ressources en eau.
L’analyse a donné lieu à plusieurs recommandations clés, dont les suivantes :
- Promouvoir des stratégies d’adaptation basées sur les écosystèmes (AbE) axées sur la restauration et la protection des écosystèmes et de la biodiversité, notamment des approches régionales en matière de l’agriculture, gestion de l’eau, préservation des forêts et économies alternatives durables;
- Améliorer la gouvernance locale et sensibiliser les populations aux lois et aux politiques de protection des ressources forestières;
- Réduire la pollution causée par l’exploitation minière pour assurer la durabilité des stratégies d’AbE.
Consulter le résumé complet du diagnostic socio-environnemental.
Principaux constats et recommandations de l’analyse des inégalités de genre
L’étude a révélé cinq grandes formes d’inégalités de genre dans les différentes provinces de mise en œuvre du projet Favoriser la résilience :
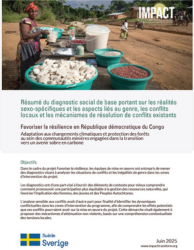
- Inégalités d’accès à la terre, les coutumes foncières étant défavorables aux femmes;
- Sous-représentation des femmes dans les structures de gouvernance locales malgré le rôle prépondérant qu’elles jouent dans la vie économique;
- Cantonnement des femmes à des tâches marginales et mal rémunérées dans le secteur minier;
- Hausse de la violence sexiste dans les régions minières;
- Accès limité des femmes à l’éducation.
L’étude s’est également intéressée aux obstacles auxquels se heurtent les Peuples Autochtones, tels que les difficultés d’accès à la propriété foncière et l’exclusion des organes décisionnels. Les Peuples Autochtones Pygmées des provinces de l’Ituri et de la Tshopo, surtout ceux qui vivent encore en forêt, éprouvent des difficultés particulières liées à leur mode de vie nomade et au manque d’accès aux services essentiels.
Dans la culture Pygmée, la notion de propriété foncière n’existe pas, ce qui complique l’inclusion de ces personnes dans les systèmes de gestion de terres et des ressources naturelles. Comme ils ne sont pas propriétaires, ils sont souvent marginalisés et exclus des circuits économiques accessibles aux autres groupes. C’est sans compter la déforestation croissante qui menace directement leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs.
Les femmes Pygmées, en raison de leur sexe et de leur ascendance autochtone, subissent une double marginalisation qui les empêche de bénéficier des mêmes chances que les autres et de revendiquer leurs droits fondamentaux.
L’étude contient plusieurs recommandations en faveur de l’inclusion et de l’autonomisation des femmes et des Peuples Autochtones, dont les suivantes :
- Renforcer le leadership des femmes;
- Remettre en question les normes sociales discriminatoires;
- Développer les capacités et l’autonomie;
- Améliorer l’accès aux débouchés économiques;
- Promouvoir l’inclusion des Peuples Autochtones et autres groupes marginalisés.
Consulter le résumé complet de l’analyse sur les inégalités de genre.
Principaux constats et recommandations de l’analyse des conflits
L’analyse a permis de relever plusieurs sources importantes de conflits et de tensions dans les provinces concernées :
- Conflits fonciers liés aux limite administratives contestées, aux expropriations et aux rivalités pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles;
- Conflits de pouvoir relatifs à l’exercice de l’autorité et à la gouvernance locale;
- Conflits identitaires découlant de l’appartenance communautaire ou d’inégalités foncières, notamment entre groupes autochtones et non autochtones;
- Conflits opposant éleveurs et agriculteurs en raison du passage du bétail dans des champs cultivés;
- Conflits liés aux ressources naturelles, un sujet de tension majeure aggravé par l’absence de gouvernance efficace et les inégalités sociales affligeant les populations vulnérables;
- Conflits miniers attribuables à divers facteurs : absence de retombées économiques locales; tensions avec les compagnies minières recourant à de la main-d’œuvre étrangère; expropriation des populations autochtones; gestion des concessions minières entre exploitants artisanaux et industriels; pollution.
Selon l’étude, ces conflits et tensions touchent les communautés locales de trois grandes manières :
- Effritement de la cohésion sociale;
- Sentiment accru d’injustice et de marginalisation;
- Risque plus élevé de violence, en particulier envers les femmes.
Selon l’étude, la cohésion sociale, la justice foncière et la gouvernance inclusive sont les clés pour transformer ces conflits en moteurs de changement propices au dialogue et au développement durable à l’échelle locale. Comme le révèle l’analyse, l’absence de mécanismes de paix constitue non seulement un vide institutionnel, mais également un facteur aggravant les tensions sociales. Dans ce contexte, la pacification des relations s’avère un volet essentiel du développement local.
Les principales recommandations issues de l’analyse des conflits sont les suivantes :
- Mettre en place des organes locaux de rétablissement de la paix dotés d’une mandat inclusif et légitime;
- Renforcer les capacités locales en médiation et en résolution pacifique des conflits par la formation, le mentorat et l’accompagnement continu;
- Instaurer des processus participatifs et transparents de gestion des ressources naturelles, notamment en matière de propriété foncière;
- Faire des femmes et des jeunes des ambassadrices et ambassadeurs de la paix en assurant leur participation systématique aux initiatives locales;
- Mener des actions de plaidoyer auprès des autorités locales et nationales en vue d’une gouvernance des ressources naturelles plus inclusive, transparente et responsable.
Consulter le résumé complet de l’analyse des conflits.
Mise en œuvre des recommandations au sein des communautés locales
Dans un contexte marqué par les effets déjà manifestes des changements climatiques, de l’exploitation minière et de la déforestation en RDC, cette étude d’envergure donne à IMPACT et à ses partenaires les clés pour connaître les défis à relever et les mesures à prendre en faveur de la résilience.
Le projet Favoriser la résilience vise à approfondir les connaissances et les compétences techniques des populations locales afin qu’elles puissent restaurer et protéger les forêts dégradées, mais aussi tirer de nouvelles sources de revenus de leur écosystème afin de compenser celles qui sont menacées par les changements climatiques. Le projet vise par ailleurs à consolider les mécanismes de gouvernance communautaire afin que les intérêts locaux soient mieux pris en compte dans la gestion des écosystèmes, notamment en plaçant le leadership des femmes et les savoirs autochtones au cœur des actions.
La RDC est un pays de première importance dans la lutte mondiale contre les changements climatiques, à la fois en raison de ses réserves de minéraux nécessaires à la transition verte et de ses vastes forêts qui contribuent à réguler le climat en emprisonnant le carbone. L’essor du secteur minier fragilise cependant l’équilibre des écosystèmes locaux jusqu’à en causer parfois la destruction. Grâce au projet Favoriser la résilience, les communautés minières artisanales seront mieux outillées pour protéger leur environnement et mieux préparées à faire face aux effets néfastes des changements climatiques.