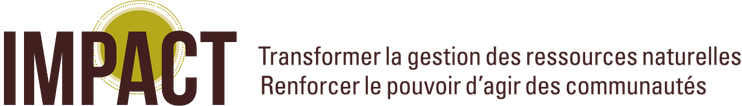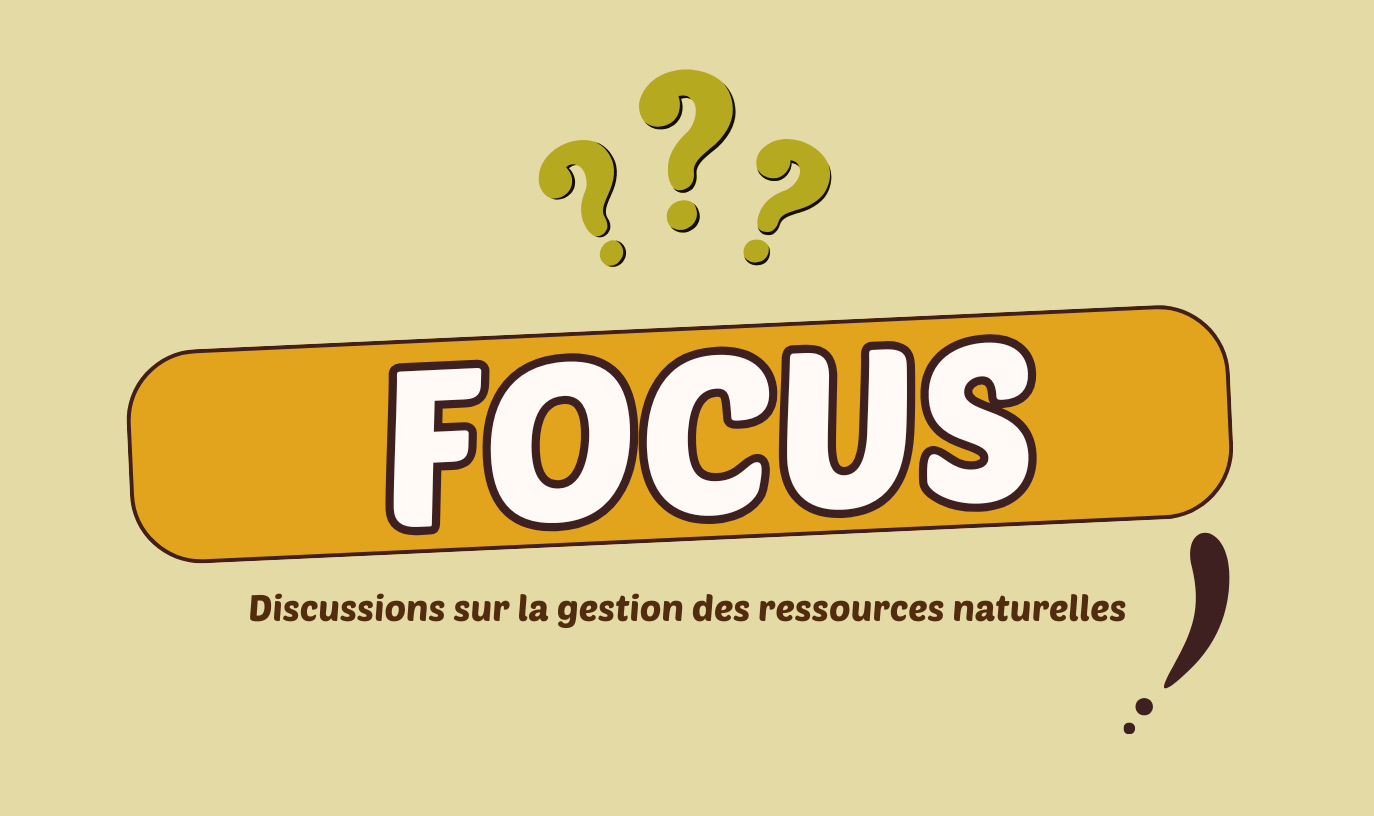Bienvenue dans notre série Focus, qui met en lumière les facteurs essentiels à l’instauration d’une chaîne d’approvisionnement en minerais responsable. Au moyen d’entrevues avec des spécialistes, nous analysons les difficultés et les innovations sur le terrain ainsi que les solutions concrètes issues de notre travail auprès des gouvernements, du secteur privé et des exploitantes et exploitants miniers artisanaux afin de soutenir leurs communautés.
Cette série, qui donne la parole à des membres de l’équipe d’IMPACT et à certains de ses partenaires, porte sur nos cinq domaines d’intervention : la réforme réglementaire et législative, la transparence de la chaîne d’approvisionnement, le commerce illicite, l’égalité des genres et la gestion de l’environnement. Elle explore les moyens à mettre en place pour harmoniser les politiques, favoriser la collaboration entre les parties prenantes et implanter des pratiques équitables dans le secteur de l’exploitation minière artisanale.
Cet article vous propose de faire la connaissance de Rose Nakawuma, chargée des associations et des coopératives du secteur de l’exploitation artisanale et à petite échelle de l’or chez IMPACT, en Ouganda. Rose dévoile les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans ce secteur et raconte comment des initiatives locales ouvrent des perspectives nouvelles en matière d’équité, de sécurité et d’autonomisation des communautés.
Le secteur de l’exploitation minière artisanale est souvent dominé par les hommes. D’après votre expérience, quels sont les facteurs structurels ou culturels qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans les postes clés de ce secteur? En Ouganda, comment les femmes tentent-elles de surmonter ces obstacles? Quelles initiatives se sont révélées particulièrement prometteuses afin de remédier à la situation?
Rose : En Ouganda, le secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) obéit encore largement à des normes sexospécifiques bien ancrées, qui tendent à en faire la chasse gardée des hommes. Dans de nombreuses communautés minières artisanales, les femmes sont impliquées, mais sont cantonnées à des rôles mal rémunérés et épuisants, tels que le lavage à la batée et le concassage du minerai. En revanche, les postes plus lucratifs, comme la propriété d’une mine, l’exploitation d’un équipement à moteur ou le commerce des minerais, sont occupés en grande majorité par des hommes, perçus comme ayant la force physique, les compétences et le soutien financier nécessaires.
Ces divisions entre les sexes sont renforcées par des obstacles structurels plus larges. L’une des idées les plus tenaces est que les tâches domestiques non rémunérées, comme la garde des enfants, la préparation des repas et l’entretien ménager, incombent essentiellement aux femmes. Ces contraintes limitent leur disponibilité et leur liberté de mouvement, et les privent des postes qui nécessitent une présence prolongée ou des déplacements vers des zones reculées. La structure même du travail est souvent le reflet de ces attentes sociales : les tâches requérant l’utilisation de machines ou de la force physique sont culturellement l’apanage des hommes. Les femmes sont ainsi systématiquement exclues de toute formation dans ces domaines.
Les stéréotypes sociaux font qu’il est encore plus difficile pour une femme d’accéder à des fonctions stratégiques et mieux rémunérées. Dans certaines communautés, on reproche aux femmes présentes sur les sites miniers de transgresser les normes sociales. Selon des croyances discriminatoires, elles porteraient même malheur, en particulier à proximité des points d’extraction. Ces idées reçues créent un environnement où les femmes n’ont pas accès aux mêmes possibilités et où elles sont activement découragées ou stigmatisées quand elles tentent de s’affranchir des rôles traditionnels.
De plus, dans ces communautés, de nombreuses femmes ont un niveau de scolarisation formelle limité et n’ont jamais eu la chance d’acquérir les compétences professionnelles, les notions financières et les pratiques de sécurité indispensables dans le secteur minier. Cette injustice les empêche souvent de négocier des salaires équitables, de gérer leur activité en toute sécurité ou d’accéder à des postes de direction au sein des coopératives minières. En outre, dans certaines cultures ougandaises – notamment chez les Baganda, dans le centre du pays –, les femmes sont soumises à des restrictions en matière d’héritage et de propriété foncière. Or, dans le secteur de l’EMAPE, l’accès à des terres riches en minerais constitue fréquemment la porte d’entrée vers des fonctions mieux rémunérées. Ces barrières juridiques et culturelles excluent de fait de nombreuses femmes des retombées économiques du secteur, ou les obligent à dépendre de membres masculins de leur entourage pour y accéder.

Toutefois, les femmes ne restent pas les bras croisés devant ces inégalités : elles s’organisent et trouvent des moyens de faire bouger les choses. Nombre d’entre elles ont intégré et formé des coopératives et des associations minières. Ces structures leur permettent de mettre en commun leurs ressources, de se soutenir mutuellement et d’accéder à des sources de financement grâce aux groupes d’épargne et de crédit. Cet élan collectif est essentiel.
On observe également l’émergence de programmes plus ciblés qui commencent à produire des résultats concrets. Par exemple, le programme planetGOLD Ouganda propose aux femmes une formation pratique sur les techniques de traitement sans mercure, l’enrichissement des minerais et le maniement des machines. L’objectif est de leur donner accès à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés. D’autres initiatives visent à renforcer leur autonomie juridique et les aident non seulement à comprendre leurs droits en matière de propriété foncière et d’héritage, mais aussi à les faire valoir et reconnaître. Quant à la société civile et aux organismes internationaux, ils plaident en faveur de l’adoption de cadres plus inclusifs en matière de genre dans les politiques publiques, afin de soutenir ces évolutions.
Si les obstacles demeurent bien réels, cette dynamique est de plus en plus forte. Chaque fois qu’une femme accède à des compétences professionnelles, à un financement, à la propriété foncière ou à un poste de direction, elle n’améliore pas simplement ses conditions de vie. Elle transforme aussi la manière dont les communautés perçoivent la place des femmes dans le secteur minier.
En quoi les associations féminines ont-elles joué un rôle clé dans la promotion de l’égalité entre les sexes au sein des communautés minières? Existe-t-il des mesures ou des indicateurs qui permettent de démontrer concrètement leurs résultats, notamment en ce qui concerne la représentation des femmes dans les postes de direction, l’inclusion, l’égalité des revenus ou l’amélioration des conditions de travail?
Rose : En Ouganda, les résultats obtenus par les associations féminines dans le secteur de l’EMAPE ne sont pas seulement visibles. Ils sont aussi mesurables.
Prenons l’exemple du leadership et de la gouvernance. Sur les 17 coopératives soutenues par planetGOLD Ouganda et IMPACT, 6 sont dirigées par des femmes, dont 3 exclusivement par elles. Les femmes représentent aujourd’hui près de 70 % des membres de ces coopératives. Il s’agit là d’un changement majeur dans un secteur où elles ont longtemps été exclues des processus décisionnels.
On observe aussi une forte hausse du nombre de femmes à la tête d’infrastructures de traitement. Il y a quelques années encore, seules deux usines de traitement de minerai appartenaient à des femmes. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 15. Ces nouvelles activités leur permettent de se libérer de la mainmise des hommes sur la production et les revenus et de créer des emplois pour toutes et tous, en vue de favoriser un accès équitable aux possibilités économiques au sein de leur communauté.
La hausse des revenus constitue un autre indicateur éloquent. Les travailleuses et travailleurs journaliers – dont la plupart sont des femmes, chargées par exemple du lavage à la batée, du concassage ou du séchage du minerai – ont vu leur salaire quotidien moyen passer de 2 000 UGX (0,54 USD) à plus de 10 000 UGX (2,69 USD). On parle donc d’une multiplication par cinq de leurs revenus, largement attribuable aux efforts de commercialisation collective, au renforcement de leur pouvoir de négociation et à l’accès à des chaînes d’approvisionnement plus stables.
Leurs conditions de travail se sont également améliorées. Le nombre de cas de violences sexistes signalés sur les sites miniers a chuté, passant d’environ deux par jour à trois par mois, selon les données de la police. Ce fort recul s’explique par une combinaison de facteurs : une meilleure gouvernance à l’échelle des sites, une sensibilisation accrue et le rôle préventif et protecteur des associations de femmes.
Ces avancées ne sont en rien le fruit du hasard : elles sont largement dues au travail de terrain mené par les associations féminines. Celles-ci ont offert une véritable tribune aux femmes, leur permettant de s’organiser, de faire entendre leur voix et d’accéder à des formations, à des services financiers ainsi qu’à un accompagnement juridique. Les femmes ont ainsi pu unir leurs forces afin de militer pour des politiques plus inclusives, de remettre en question des normes préjudiciables et de consolider leur pouvoir de négociation au sein de la chaîne de valeur aurifère.
Les pouvoirs publics commencent à s’inscrire eux aussi dans cette dynamique. En se constituant en coopératives, les femmes ont accès à de nouvelles formes d’aide et peuvent notamment bénéficier d’initiatives gouvernementales. Par exemple, le projet GROW (Generating Growth Opportunities and Productivity for Women Enterprises ou Renforcer les possibilités de croissance et de productivité des entreprises dirigées par des femmes) – piloté par le ministère ougandais du Genre, du Travail et du Développement social – prévoit désormais une aide ciblée à l’intention des coopératives d’exploitantes minières. Il leur propose entre autres un soutien technique et un meilleur accès au financement, ce qui accroît encore le rôle des associations dans l’amélioration des conditions de travail et le renforcement de l’inclusion au sein du secteur.
Quels sont les principaux freins à la création de coopératives efficaces, et comment ces obstacles varient-ils d’une région ou d’un contexte à l’autre? Comment abordez-vous certains enjeux majeurs, comme l’instauration de la confiance ou le renforcement des capacités et du leadership des femmes?
Rose : Afin de favoriser la création de coopératives efficaces, il faut en priorité travailler à l’instauration d’un lien de confiance avec les exploitantes minières artisanales ainsi qu’au renforcement du leadership des femmes et de leurs capacités.
Il ne s’agit pas de mettre en place de simples solutions techniques, mais d’apporter une réponse directe aux obstacles sociaux, culturels et structurels auxquels se heurtent les exploitantes minières dans différentes régions du pays.
S’il est tellement essentiel de tisser un lien de confiance avec les travailleuses sur le terrain, c’est que bon nombre d’entre elles se montrent sceptiques à l’égard des coopératives et sont échaudées par l’échec de précédentes initiatives, parfois mal gérées ou malhonnêtes. D’autres ont reçu des informations contradictoires ou ne comprennent pas vraiment le fonctionnement d’une coopérative. L’expérience nous a montré qu’il fallait faire preuve de transparence. Des réunions ouvertes, une planification inclusive et une communication claire offrent, dès le début, un gage de crédibilité. La mise en place de mécanismes simples de reddition de comptes et la création d’espaces d’échange favorisent la rétroaction et l’appropriation, tout en aidant à prévenir les conflits internes. Dans les communautés divisées ou fracturées, instaurer la confiance, c’est aussi veiller à faire entendre toutes les voix en reflétant la diversité sociale à l’échelle de la direction.
Nous avons observé que les coopératives prospéraient quand les personnes à leur tête étaient non seulement compétentes sur le plan technique, mais aussi représentatives et respectées dans leur communauté. Pour y parvenir, les formations sont axées sur la gouvernance participative, la gestion financière, la communication et la résolution des conflits. L’équipe de direction est par ailleurs élue démocratiquement. Son mandat est bien défini et limité dans le temps, afin de favoriser la responsabilisation. Souvent, des exercices inspirés de situations réelles sont proposés. L’objectif est de résoudre un problème, en vue de renforcer la confiance en soi et les compétences décisionnelles – un aspect essentiel lorsque l’accès à l’éducation formelle est limité.
Le renforcement des capacités bénéficie à la fois à l’association et à ses membres. Les formations visent à initier les femmes à la gestion financière, à des pratiques minières plus sécuritaires et plus efficaces, à la responsabilité environnementale ainsi qu’au développement économique. Au-delà de leur dimension strictement technique, les visites de terrain et les interactions avec des acteurs publics et privés permettent aux exploitantes minières de mieux comprendre leur rôle dans des systèmes plus larges. Ces échanges leur donnent également l’occasion de participer aux politiques publiques et d’accéder aux marchés officiels. Dans bien des cas, grâce à ces outils, les exploitantes minières ne perçoivent plus leur adhésion à une coopérative du même œil. Au lieu de la considérer comme un risque, elles y voient un investissement à long terme.
Ces approches répondent directement aux réalités du terrain. Par exemple, dans les régions où les travailleuses doivent se déplacer fréquemment d’un site à l’autre, nous veillons à instaurer des processus d’adhésion flexibles. Si les exploitantes minières n’ont pas de carte d’identité – nécessaire à l’enregistrement de leur coopérative –, des partenaires locaux les aident à remédier au problème. Et quand les structures de pouvoir traditionnelles en place s’opposent à une organisation formelle, des séances de mentorat par les pairs et des exemples d’initiatives réussies dans des communautés similaires contribuent souvent à faire évoluer les perceptions.
Quelles lacunes subsistent dans les cadres réglementaires existants, notamment en matière de droit du travail, de propriété foncière et d’accès au financement des exploitantes minières? Comment des innovations politiques ou des projets collaboratifs pourraient-ils contribuer à les combler?
Bien que des progrès aient été réalisés sur le papier, d’importantes lacunes réglementaires continuent d’empêcher la pleine participation des femmes. Ces manquements sont particulièrement flagrants dans les domaines de la protection des travailleuses, du droit à la propriété foncière et de l’accès au financement.
Dans de nombreuses communautés minières, les femmes sont considérées comme des travailleuses occasionnelles et, par conséquent, exclues des protections prévues par la loi ougandaise sur l’emploi. Ainsi, elles travaillent souvent sans contrat et sont victimes de discriminations salariales. Elles n’ont pas non plus accès aux avantages sociaux, tels que les congés de maternité ou la sécurité de l’emploi. Comme leur statut n’est pas officiellement reconnu, elles échappent aussi aux inspections du travail, ce qui les rend plus vulnérables à l’exploitation et aux risques d’accident.
L’accès à la propriété foncière constitue un autre défi majeur. Certes, la politique nationale de 2013 en la matière reconnaît le droit des femmes à posséder des terres. Mais, dans les faits, ce texte demeure peu appliqué et ne prévoit que de rares sanctions en cas de discriminations sexistes lors de la répartition de biens fonciers ou d’un héritage. En outre, les femmes ne disposent que de recours limités lorsque leurs droits sont bafoués. Pourtant, l’accès à des terres riches en minerais constitue une condition sine qua non à la participation équitable des femmes au secteur. Faute de pouvoir investir, diriger ou posséder une mine, leur autonomie économique demeure donc restreinte.
De plus, en Ouganda, les dispositifs de microfinance en vigueur ne tiennent pas compte des besoins propres aux femmes dans le secteur de l’EMAPE. La plupart des établissements financiers considèrent le secteur comme trop risquée et exigent des garanties, souvent des titres fonciers, dont la majorité des femmes ne disposent pas. Par conséquent, elles rencontrent de grandes difficultés à obtenir les capitaux nécessaires à l’achat d’équipements, à la création d’installations de traitement ou à l’enregistrement officiel de leur activité.
Pour y remédier, il faut non seulement mettre en place des innovations politiques, mais aussi des solutions intersectorielles collaboratives.
En ce qui concerne le droit du travail, il est clairement nécessaire de réviser la législation en vigueur afin de mieux refléter les réalités du marché de l’emploi informel, tout en étendant les protections existantes. Cette réforme peut passer par l’instauration de mécanismes visant à formaliser le travail occasionnel dans le secteur de l’EMAPE. Il s’agirait, par exemple, d’introduire des contrats de travail simplifiés ou de garantir certaines protections aux travailleuses, quel que soit leur statut contractuel. Les normes de travail doivent aussi être élargies et prévoir la mise en place de salaires équitables, de congés de maternité et de mesures de santé et de sécurité.
S’agissant des droits fonciers, l’application effective de la loi est primordiale. Il est en outre nécessaire de renforcer les mécanismes juridiques qui permettent aux femmes de contester les pratiques discriminatoires et de faire valoir leurs droits en matière de propriété et d’héritage. Des services juridiques à la demande et des programmes communautaires d’éducation au droit peuvent également les aider à comprendre et à exercer leurs droits, en particulier dans les zones rurales où l’application de la loi est plus limitée.
Par ailleurs, les parties prenantes pourraient mettre en place des modèles de financement axés sur le genre, notamment des dispositifs de crédit à faible taux d’intérêt garantis par l’État ou des partenariats avec des coopératives d’épargne et de crédit et des établissements de microfinance. Quoi qu’il en soit, les programmes doivent être conçus pour répondre aux besoins particuliers des exploitantes minières artisanales (initiation à la finance, assouplissement des conditions de garantie, instauration de mécanismes de partage des risques pour faciliter l’accès au crédit, etc.).
En somme, il faut adopter une approche à deux niveaux afin de combler ces lacunes : d’une part, des réformes politiques menées par le haut visant à rendre les cadres plus inclusifs et applicables; d’autre part, des innovations portées par le terrain, à l’aide de projets adaptés aux réalités des femmes.
Il peut être difficile d’instaurer la confiance et de favoriser la collaboration à l’échelle communautaire. Comment gérez-vous les dynamiques sociales complexes sur le terrain afin de mener à bien des initiatives en faveur de l’égalité des genres, de l’approvisionnement responsable et de l’autonomisation des communautés dans les régions minières?
La clé pour changer la donne dans le secteur de l’EMAPE, notamment en matière d’égalité des genres et d’approvisionnement responsable, c’est la confiance. Et elle ne peut naître que dans une approche patiente et respectueuse, menée par les communautés elles-mêmes.
Chaque communauté dispose de son propre tissu social. Plutôt que d’imposer des solutions extérieures, il est essentiel de commencer par écouter et comprendre les normes, les processus décisionnels et les méthodes de résolution des conflits ayant cours à l’échelle locale. Les interventions gagnent en efficacité lorsqu’elles s’inscrivent dans les valeurs et les systèmes existants, au lieu de les perturber.

Le changement, a fortiori quand il concerne les rôles sociaux liés au genre ou la gouvernance, ne peut s’opérer que de façon progressive. En effet, les transformations brutales suscitent le plus souvent résistances et crispations. Mais quand les échanges sont respectueux de la culture locale et visent des objectifs communs – comme l’amélioration des moyens de subsistance ou des conditions de travail –, les communautés se montrent plus réceptives aux idées nouvelles.
Il est en outre indispensable de comprendre les dynamiques de pouvoir en place. Négliger les chefs traditionnels, les figures religieuses, les responsables de coopératives ou même les personnes exerçant une influence informelle serait une erreur. C’est au contraire en les associant dès les premières étapes que l’intervention gagne en légitimité aux yeux de la communauté. Et lorsque ces personnalités sont impliquées, elles peuvent également expliquer les objectifs du projet, afin d’en accentuer la résonance locale et de renforcer l’adhésion et l’acceptation de la population. Voilà pourquoi elles doivent clairement comprendre les tenants et les aboutissants de l’initiative avant son lancement. À ce stade, une communication ouverte leur donne les moyens de défendre le projet en toute confiance et permet d’éviter les malentendus. C’est sur cette base qu’il devient possible de mobiliser le reste de la communauté.
Il est aussi important d’avoir conscience qu’un véritable changement prend du temps. Célébrer les petites avancées – comme une participation accrue des femmes aux réunions ou l’adoption de pratiques plus sûres sur un site minier – permet de maintenir la dynamique et de montrer que le progrès est en marche.
Enfin, en témoignant un profond respect des valeurs de la communauté, on envoie un signal fort à l’ensemble du groupe : l’intervention n’a pas pour objectif de supplanter l’identité locale, mais bien de prendre appui sur elle. Dans des contextes complexes, une transformation ne peut avoir lieu que si chaque personne se sent reconnue, écoutée et pleinement impliquée. Il est donc essentiel de donner la priorité aux connaissances locales, de partager les pouvoirs et de faire preuve de transparence tout au long du processus. C’est l’unique moyen d’instaurer une confiance durable – et, avec elle, un changement pérenne.

À propos de Rose Nakawuma
Rose Nakawuma est chargée des associations et des coopératives du secteur de l’exploitation artisanale et à petite échelle de l’or chez IMPACT, en Ouganda. Depuis de nombreuses années, elle soutient les groupes miniers artisanaux dans leurs efforts de formalisation et met l’accent sur des solutions pratiques, adaptées aux défis du secteur. Rose dispose en outre d’un solide bagage en mobilisation communautaire et en résolution des conflits. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université internationale de Kampala et d’un diplôme de pratique juridique du Centre de développement du droit de l’Ouganda.