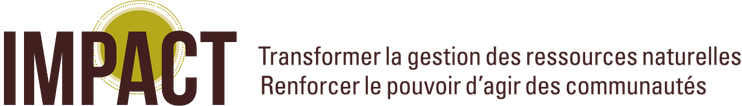Au lever du jour, dans le district de Kasanda en Ouganda, Aisha, exploitante d’or artisanale et membre d’une coopérative, se prépare pour une nouvelle journée de travail. Des années durant, le mercure a fait partie de son quotidien. Accessible, familier, efficace, ce liquide a pourtant des effets hautement néfastes sur la santé et l’environnement; des effets que les exploitantes et exploitants ont fini par accepter comme un mal nécessaire. Toutefois, lorsque la Loi ougandaise sur les mines et minéraux (2022) en a officiellement interdit l’usage dans le secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) et que son prix s’est envolé, Aisha a commencé à remettre ses pratiques en question. Encouragée par ses collègues et formée grâce au projet planetGOLD, elle a osé passer à des méthodes sans mercure. Depuis, ses revenus ont plus que doublé et son parcours inspire d’autres personnes qui empruntent la même voie semée d’incertitudes.
Ces dernières années, l’équipe d’IMPACT a vu le prix du mercure en Ouganda bondir pour passer de 800 000 UGX (218,30 $ US) le kilo à près de 1,8 million d’UGX (490,86 $ US), une hausse attribuable à la réglementation internationale et aux adaptations à l’échelle locale. Depuis son interdiction en Ouganda, le mercure transite principalement par le marché noir, en particulier par le Kenya. Ce commerce illicite fait non seulement grimper les prix, mais intensifie les risques liés à la contrebande et à l’illégalitédu produit; ce qui accroît la vulnérabilité des exploitantes et exploitants qui en dépendent.
Ces derniers doivent faire des choix difficiles. Les broyeurs à tambour humide destinés à faciliter la transition vers un traitement sans mercure sont désormais détournés de leur usage dans certaines régions. Leur fonctionnement repose sur de lourdes meules qui pulvérisent le minerai afin d’en extraire les particules d’or. Ils sont généralement utilisés avec des réservoirs de cyanuration, où l’or est chimiquement extrait du minerai concassé au terme d’un long procédé. Au lieu de récupérer les résidus miniers pour les soumettre à la cyanuration, certains exploitants et exploitantes introduisent du mercure directement dans les broyeurs pour accélérer la récupération de l’or. Là où la cyanuration peut prendre plusieurs semaines, l’amalgamation permet d’obtenir un peu d’or chaque jour, un avantage vital pour celles et ceux qui ont des besoins financiers urgents à combler.
Mais ce raccourci n’est pas sans conséquences. Le mercure se lie à l’or et aux autres métaux à l’intérieur du broyeur, ce qui produit un amalgame impur. L’or qui en résulte se vend au rabais en raison des pertes occasionnées durant le raffinage. Par ailleurs, lorsque le minerai est broyé trop longtemps, le mercure se décompose et se disperse dans l’environnement sous forme de résidus toxiques. Rappelons que l’ajout direct de mercure dans le broyeur – un procédé appelé « amalgamation du minerai brut » – est considéré comme l’une des pires pratiques par la Convention de Minamata. Cette méthode contamine non seulement le matériel minier, mais pollue l’environnement et libère des vapeurs toxiques.
Les exploitantes et exploitants miniers ne sont pas sans connaître les risques liés à l’utilisation du mercure. Plusieurs artisans miniers aimeraient passer à une autre méthode, mais la transition vers des procédés sans mercure exige des capitaux de départ souvent prohibitifs, surtout pour les femmes.
Aisha a surmonté cet obstacle en saisissant une chance inespérée. Le propriétaire de la mine où elle avait acheté du minerai l’a autorisée à le transformer sans frais à l’aide du système de cyanuration sans mercure déjà en place. Cet arrangement lui a permis de tester le procédé sans avoir à interrompre son travail, ni à engager de lourdes sommes. Encouragée par les rendements élevés, elle s’est résolue à épargner ses revenus quotidiens et à les réinvestir dans l’espoir d’en tirer des bénéfices à long terme. Grâce à un procédé de cyanuration adéquat, elle gagne maintenant plus du double qu’avec le mercure.
Et son succès en inspire d’autres. Voyant que les procédés sans mercure peuvent produire de l’or en seulement deux ou trois jours, soit bien plus vite que les deux mois habituels, les exploitantes et exploitants comprennent que la transition n’est pas seulement souhaitable, mais indispensable. Si la cyanuration complète prend habituellement plusieurs semaines, des méthodes de récupération partielle comme l’agitation à petite échelle et l’extraction par boue de carbone peuvent produire des quantités d’or utilisables en quelques jours; ce qui offre un compromis viable entre rapidité et sécurité.
Les démarches visant à faire respecter la Loi ougandaise sur les mines et minéraux (2022) continuent d’évoluer, des efforts étant en cours pour harmoniser le cadre juridique avec les pratiques sur le terrain. En témoigne une récente formation donnée à l’Unité de protection des minéraux de la police, qui souligne la nécessité de renforcer les capacités en matière de gestion des preuves et d’application des procédures judiciaires. Les services douaniers approfondissent eux aussi leurs connaissances afin de mieux détecter et gérer les cargaisons de mercure susceptibles d’échapper aux contrôles.
Des lacunes réglementaires au Zimbabwe
Au Zimbabwe, la Loi sur la gestion de l’environnement encourage des pratiques respectueuses de l’environnement et appuie les engagements pris par le pays dans le cadre de la Convention de Minamata. Toutefois, aucune disposition n’interdit expressément l’usage du mercure dans le secteur de l’EMAPE.
Il subsiste également des obstacles à l’application réglementaire, notamment en raison d’un manque de ressources et de capacités au sein des organismes concernés. Certes, les lois zimbabwéennes sur les mines et minéraux et sur la gestion de l’environnement font actuellement l’objet de révisions, mais leurs avant-projets ne comportent pas de clauses relatives au mercure. Cette situation souligne la nécessité d’une coopération durable entre l’État, les ONG et les communautés minières afin de mieux faire respecter les lois et de favoriser des pratiques minières plus sûres, plus rentables et plus responsables.
Par ailleurs, des données préliminaires suggèrent que le coût élevé et l’inaccessibilité des produits chimiques provenant de fournisseurs autorisés découragent les achats légaux. En conséquence, la plupart des exploitantes et exploitants dépendent de petites quantités de mercure achetées sur le marché noir – parfois aussi peu qu’une cuillerée à thé vendue à un prix aussi élevé que 15 $ US – en provenance surtout du Mozambique. Le mercure est toujours en usage, faute de substituts abordables et en raison de la facilité d’accès des produits de source informelle. Dans les localités touchées par la flambée des prix de l’or, ce phénomène a fait grimper le coût des produits essentiels. Certains y voient les effets de l’afflux de liquidités généré par les ventes d’or; ce qui exerce une pression à la hausse sur les prix des produits locaux et réduit le pouvoir d’achat des exploitantes et exploitants.
Ces dynamiques de marché illustrent l’ampleur du problème. Même si les réformes politiques tardent à se concrétiser, le projet planetGOLD Zimbabwe engage un dialogue avec l’État, la société civile et les communautés minières afin de combler ces lacunes réglementaires et d’encourager des pratiques plus sûres sur les sites miniers.
Vers de meilleures pratiques en Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, l’article 68 du Code minier (2014) et l’article 69 de son décret d’application interdisent l’usage de produits chimiques, dont le mercure, dans le secteur de l’EMAPE. Cette interdiction est renforcée par le Code de l’environnement (2023) et la Convention de Minamata, dans sa version ratifiée par la Côte d’Ivoire. Malgré tout, l’usage du mercure demeure largement répandu dans les exploitations minières artisanales et à petites échelles de l’or.
Selon les observations d’IMPACT, le mercure se vend environ 500 francs CFA (0,85 $ US) les 10 grammes. À défaut de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour manipuler correctement cette substance, les exploitantes et exploitants artisanaux en utilisent souvent deux ou trois fois plus que nécessaire, soit bien plus que la quantité de 1,3 gramme requise pour extraire 1 gramme d’or.
Des procédés de rechange comme l’emploi de borax et la cyanuration sont encore largement méconnus, quoique certains acteurs s’y intéressent de plus en plus. Pour combler ce fossé, le projet planetGOLD Côte d’Ivoire a mis en place une démarche par étapes : réalisation d’une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP); collaboration avec une ONG locale pour sensibiliser les artisans miniers et les communautés de cinq sites-pilotes; tenue de formations portant sur la manipulation sécuritaire du mercure, la démonstration de substituts comme le borax et la distribution d’équipements de protection individuelle.
Les obstacles au changement sont nombreux : peu d’informations circulent sur les substituts, ceux-ci sont rarement accessibles sur les sites miniers, et les démarches d’homologation de certains procédés sans mercure et équipements de traitement à petite échelle sont juridiquement lourdes. Par ailleurs, il est difficile de parler ouvertement de l’usage du mercure avec les exploitantes et exploitants, qui redoutent les sanctions ou se méfient des autorités. Le projet planetGOLD vise à surmonter plusieurs de ces obstacles de fond en gagnant la confiance des populations et en encourageant l’adoption progressive de meilleures pratiques.
Sur les plans économique et environnemental, le mercure a des répercussions plus vastes encore : il contamine les sols et les cours d’eau, en plus d’amoindrir les rendements agricoles. Les conséquences sociales et sanitaires, quant à elles, demeurent sous-documentées, en raison d’une sensibilisation limitée, tant au sein des communautés minières que parmi les professionnels de la santé, que les symptômes liés au mercure sont souvent lents à se déclarer et difficiles à dépister. Un meilleur encadrement réglementaire, une sensibilisation accrue des artisans miniers et des populations locales sur les dangers du mercure; le tout appuyé par une collaboration multipartite, un accès élargi aux substituts et un suivi médical dans les communautés minières contribueraient à des pratiques plus durables. Pour ce faire, plutôt que de recourir systématiquement aux mesures répressives ou coercitives, il faut privilégier des approches collaboratives visant à établir un climat de confiance entre les exploitantes et exploitants, les autorités et la société civile.
En finir avec le mercure
Sur le continent africain, la mise en œuvre de la Convention de Minamata et l’interdiction du mercure ont fait basculer le commerce de ce produit chimique dans l’illégalité et exercé une pression à la hausse sur les prix. En réponse à cette situation, des initiatives comme le projet planetGOLD encouragent de meilleures pratiques et des solutions plus sûres pour les négociants ainsi que les exploitantes et exploitants affligés par les contraintes réglementaires et l’amenuisement des profits.
Le changement est en marche, porté par les réformes, mais aussi par l’expérience vécue sur le terrain. Là où des exploitantes et exploitants comme Aisha ouvrent la voie, d’autres leur emboîtent le pas. L’apprentissage entre pairs s’impose comme l’un des meilleurs outils pour contrer l’usage du mercure. Les membres de coopératives qui sont passés à d’autres méthodes partagent activement leurs connaissances et montrent que des procédés plus sûrs peuvent tout à fait être efficaces… et profitables. En Ouganda comme en Côte d’Ivoire, IMPACT a pu constater le rôle essentiel que jouent les coopératives partenaires locales en guidant leurs membres et en formant d’autres groupes aux démarches de formalisation et aux pratiques minières responsables.
L’abandon du mercure est rarement un choix idéologique. Il s’agit d’un choix pratique et économique souvent urgent. Grâce au renforcement des mécanismes de mise en application et à des procédés de rechange plus accessibles, les exploitantes et exploitants réalisent qu’ils ne sont plus seuls face au problème. L’abandon du mercure en Ouganda, au Zimbabwe et en Côte d’Ivoire est plus qu’une simple formalité réglementaire. Il s’agit d’un tournant décisif pour l’avenir du secteur et des populations qui en dépendent.
Grâce à des lois plus fermes, à l’apprentissage entre pairs et à une meilleure compréhension des véritables coûts du mercure, les communautés minières artisanales redessinent peu à peu les contours d’une extraction aurifère responsable. La réglementation n’en demeure pas moins cruciale. Si un cadre réglementaire bien conçu peut baliser des pratiques plus sécuritaires, une mise en œuvre laxiste ou arbitraire risque au contraire de compromettre les progrès même les plus encourageants.
Pour que le changement s’inscrive dans la durée, les politiques doivent être assorties d’investissements soutenus dans la formation, les infrastructures et les mécanismes d’accompagnement accessibles aux exploitantes et exploitants. Elles doivent également s’accompagner d’une coopération régionale et internationale. Grâce à des initiatives comme la Convention de Minamata et le programme planetGOLD, l’impulsion est donnée partout dans le monde. Mais, dans un contexte de porosité des frontières et de décentralisation de l’approvisionnement, la fermeture d’un point d’accès en laisse souvent bien d’autres ouverts. D’où, l’importance des initiatives régionales pour donner plus de poids aux actions nationales visant à endiguer ce phénomène.
Il est tout aussi essentiel de veiller à ce que la mise en pratique des principes reflète la réalité des économies informelles, surtout là où l’activité minière est criminalisée ou fortement stigmatisée. Soutenir le changement dans ce contexte exige de bâtir la confiance, d’appliquer la réglementation avec souplesse et d’adopter des mécanismes de suivi inclusifs. Ce n’est qu’en arrimant des politiques fortes aux réalités locales que nous pourrons réduire pour de bon l’usage du mercure dans le secteur de l’EMAPE.
Les projets planetGOLD Côte d’Ivoire, Ouganda, et Zimbabwe sont soutenus par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et dirigés par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).
- En Côte d’Ivoire, IMPACT met en œuvre le projet avec le Centre Africain pour la Santé et l’Environnement (CASE).
- En Ouganda, IMPACT est une agence de mise en œuvre en partenariat avec l’Autorité Nationale de Gestion de l’Environnement (NEMA) et le Ministère de l’Énergie et du Développement Minier du pays, sous la direction du Département des Mines.
- Au Zimbabwe, IMPACT est une agence de mise en œuvre en partenariat avec le ministère des Mines et du Développement minier, le ministère de l’Environnement, du Climat et de la Faune et l’Agence de gestion de l’environnement.